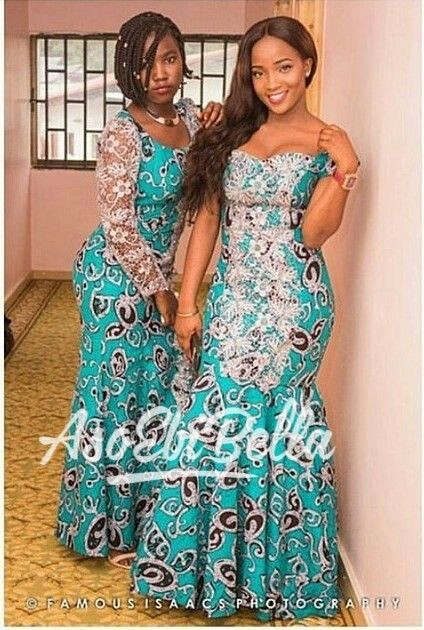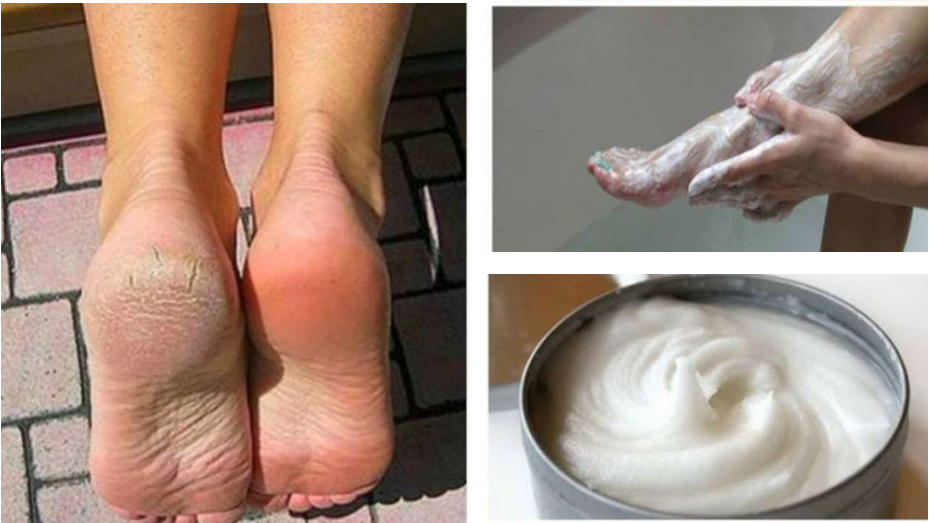Dans les villages reculés d’Afrique de l’Ouest, les mains expertes des teinturières dansent encore sur les étoffes. Plongées jusqu’aux coudes dans des bains aux couleurs vives, ces gardiennes d’un savoir-faire millénaire perpétuent des gestes transmis de mère en fille depuis des générations. Mais ne nous voilons pas la face : cette tradition s’essouffle face à l’industrialisation galopante et l’arrivée massive des tissus chinois bon marché.




J’ai rencontré Aminata, 72 ans, qui me confie entre deux plongées de tissu dans son bain d’indigo : « Mes petites-filles préfèrent l’université à mon atelier. Je ne peux pas leur en vouloir, mais qui perpétuera nos motifs quand mes doigts seront trop raides ? » Une question qui résonne comme un glas dans l’air chargé d’effluves de plantes tinctoriales. Les pigments naturels extraits de l’indigo, du safran ou du bois de campêche sont progressivement remplacés par des colorants chimiques, moins chers mais aussi moins résistants et plus polluants.





Pourtant, un espoir subsiste. Des initiatives de valorisation émergent timidement, portées par des créateurs de mode éthique et des ONG culturelles. Ces projets visent à documenter les techniques de teinture traditionnelles tout en offrant des débouchés économiques aux artisanes. Car c’est peut-être là que réside la solution : transformer ce patrimoine en une ressource économiquement viable pour les nouvelles générations, sans dénaturer l’âme de cet art ancestral qui raconte, à travers ses motifs et ses couleurs, toute l’histoire d’un continent.





.





.





.





.





.





.





.




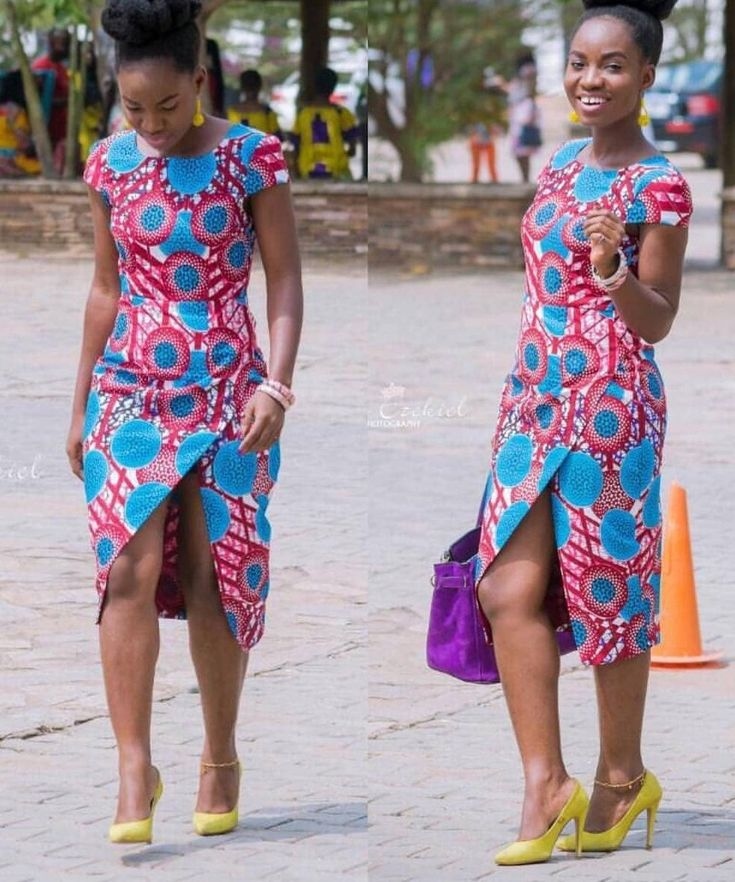
.





.





.



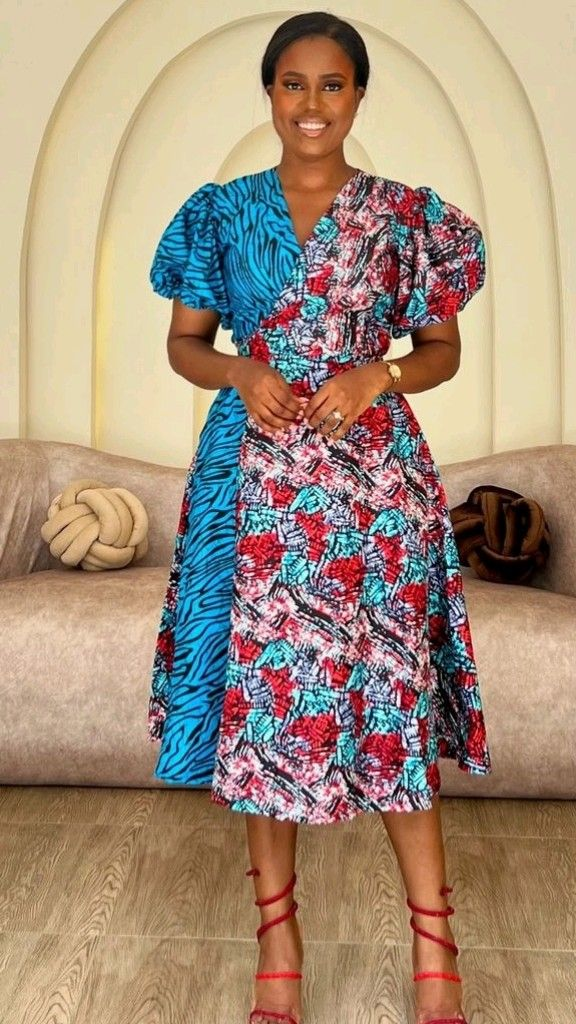

.